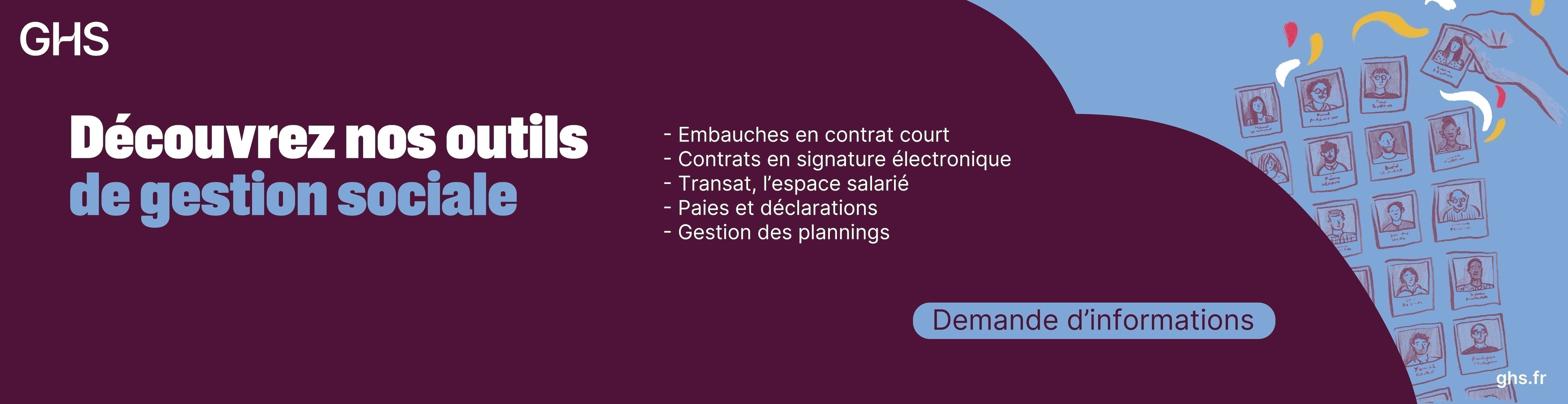Entre indifférence du public et qualité sonore aléatoire, ouvrir pour le concert d’une vedette est souvent ingrat. Pourtant, cela reste un enjeu important pour un artiste débutant mais aussi pour les tourneurs et les salles de concert.
«Il y a à tout gagner. Personne ne t’attend, personne n’a acheté une place pour te voir à part ta famille ou les potes. Les conditions ne sont pas toujours bonnes. On t’a mis là où il reste de la place sur scène, tu dois composer avec les miettes. Mais quel panache si, à la place de la tête d’affiche, les gens se souviennent surtout de toi. C’est David contre Goliath, à la même manière de ces petits clubs de foot qui battent une grosse équipe en Coupe de France.» Simon Nodet expose une de ses visions de la première partie qu’il reconnaît comme romantique. Il n’empêche, le directeur de W Spectacle (société de production de spectacles du groupe Wagram) a parfois vu celui chargé d’ouvrir la soirée faire meilleure impression que la tête d’affiche. Le devoir de réserve l’empêche d’évoquer son propre catalogue, mais, en tant que spectateur, il cite volontiers l’exemple du groupe anglais Editors qui lui avait laissé un souvenir bien plus percutant que Franz Ferdinand lors d’une date à Grenoble. Peu fréquente, cette situation existe néanmoins et peut engendrer des tensions. Ainsi, la légende veut qu’au début des années 80, Indochine ait été viré en pleine tournée par le manager de Taxi Girl. La raison ? Il volait la vedette à la formation emmenée par Daniel Darc.
Au-delà de l’anecdote, l’exercice de la première partie génère des enjeux multiples. Déjà, parce que c’est un passage quasi obligatoire pour les artistes émergents qui, dans un temps offert ne dépassant jamais la demi-heure, doivent faire leurs preuves devant un public qui généralement ne les connaît pas. «La plupart n’ont pas encore de fan base. C’est à la fois une première confrontation avec un potentiel public et une manière d’apprendre le métier. Cela permet ainsi de travailler l’entente et le placement, le travail du son sur scène et en façade», explique Thierry Langlois, fondateur et gérant d’Uni-T, société de production de concerts. «Bien souvent, il y a plus de douleur que de plaisir. Ils ont peu de temps pour s’installer, faire la balance, doivent fréquemment jouer devant les instruments de la tête d’affiche sans compter que les gens ne sont pas toujours arrivés ou préfèrent rester au bar pendant leur prestation.» Julien Catala, son confrère de chez Super, y voit là aussi une occasion dans son activité de tourneur-producteur de tester le potentiel des artistes en vue d’une éventuelle collaboration : «Avant de les signer, c’est bien de pouvoir mesurer la qualité musicale en live mais aussi le lien humain. S’ils sont agréables, bien organisés, ça incite à travailler avec eux.» Il compare la première partie à un show promotionnel, arguant qu’elle n’a évidemment pas destination à susciter un achat massif de billets et réclame une configuration scénique légère, tandis que Marion Gabbaï ajoute que c’est un axe de communication non négligeable. «Si on arrive à mettre quelqu’un de notre écurie en ouverture de Juliette Armanet ou de Clara Luciani, on va forcément le faire savoir auprès des programmateurs. Jouer devant des milliers de gens, ça accroît la valeur de l’artiste.»
Sachant que son catalogue est très majoritairement composé d’internationaux tendance indie-rock (The Jesus & the Mary Chain, Half Moon Run, The Notwist…), celle qui tient les rênes de l’agence Vedettes n’a généralement pas son mot à dire sur le choix de la première partie. Dans le cadre d’une date d’un artiste étranger, il est en effet quasiment impossible de suggérer un groupe en support. «A partir d’une salle de plus de 500 personnes comme la Maroquinerie à Paris, neuf fois sur dix, la première partie nous sera imposée et c’est la plupart du temps la même qui va faire toute la tournée européenne de la tête d’affiche. En dessous de cette capacité, on peut nous solliciter pour qu’on fasse une proposition, soumise bien sûr à validation du management», observe-t-elle. Plus la jauge d’accueil est grande, plus la notoriété du groupe ou de l’artiste choisi pour chauffer le public est importante. Récemment, c’est Paramore qui a ouvert pour la méga star Taylor Swift lors de sa série triomphale de concerts (près de 180 000 spectateurs au total) à La Défense Arena. Auréolée cette année du Grammy Awards de l’album rock, la formation américaine de la chanteuse Hayley Williams pèse suffisamment pour remplir un Zénith parisien sur son seul nom.
Dédit de bar
Ces salles à forte capacité appliquent une politique qui incite les producteurs à ne pas faire l’impasse sur cette pratique. A défaut de première partie, elles sont en droit de leur demander ce qu’on appelle un dédit de bar. «On doit payer dans ces cas-là une différence pour que le bar soit fermé puisqu’il n’y aura pas d’entracte. C’est suffisamment élevé pour se dire qu’on ne va pas jeter de l’argent par les fenêtres pour rien», souligne Julien Catala.
Placer un artiste en support d’un concert principal, c’est évidemment miser sur l’avenir pour le producteur de concerts mais pas à n’importe quel prix. Simon Nodet, de W Spectacle, assure ne pas foncer tête baissée et s’octroie la possibilité de refuser. Parce que jouer en lever de rideau nécessite de mettre un gros billet sur la table. «Les cachets offerts ne permettent quasiment jamais de rentrer dans ses frais», affirme-t-il. Selon la jauge de la salle, le tourneur récupère en moyenne entre 150 et 500 euros qui doivent couvrir le salaire de l’artiste, de ses musiciens, de ses techniciens, l’hôtel, le transport, la location du backline (les instruments additionnels). «En général, les frais engagés sont d’environ 2 000 euros. Il faut donc absolument qu’il touche le public, que l’essai soit transformé sur ses réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Si rien ne se passe derrière, c’est la double peine. Tu as engagé de l’énergie, du temps et de l’argent que tu ne reverras jamais.» Simon Nodet remarque par ailleurs que les artistes et leur manager fantasment souvent sur la perspective de faire des premières parties : «Si on s’engage avec vous, est-ce que vous allez être en mesure de nous en déclencher ? Cette question est récurrente. Mais cette obsession se révèle souvent une erreur. J’en connais beaucoup qui ont enchaîné les premières parties pour des artistes importants sans que cela n’ait un impact énorme sur leur carrière.»
Rares sont ceux qui ont vu leur trajectoire décoller grâce uniquement aux premières parties. L’auteur-compositeur-interprète Gauvain Sers, habitué jusque-là aux petits lieux dédiés à la chanson, a connu une ascension fulgurante lorsqu’il a été contacté par Renaud en octobre 2016 afin, dans un premier temps, d’introduire ses concerts parisiens au Zénith. Finalement, il effectuera les 102 dates de la tournée pour une affluence estimée à 500 000 spectateurs. «J’ai compris ce qu’il se passait au moment de l’entracte. Beaucoup de gens venaient s’arrêter dans le hall d’entrée pour une dédicace et acheter mon EP que j’avais enregistré avec les moyens du bord, raconte-t-il. Au départ, on en avait filé quelques-uns à la salle. Au bout de deux, trois représentations, on m’a demandé de changer de braquet et d’approvisionner massivement le stock. Il paraît qu’on n’avait pas vu un tel engouement depuis Bénabar en première partie d’Henri Salvador. On vendait en moyenne 200 de mes disques chaque soir.» Sans même bénéficier d’une exposition radio conséquente, Gauvain Sers se hisse grâce à ces seules premières parties en tête des ventes au moment de la sortie de son premier album. Plus tard, il apprendra que le «chanteur énervant» avait dû batailler contre vents et marées pour l’imposer. «Au début, je sentais que j’avais une petite cible dans le dos, sourit-il. Le tourneur de Renaud voulait placer ses jeunes poulains, son label aussi. Ça les aurait arrangés que je me plante, pour imposer un changement de première partie.»
Lire la suite sur liberation.fr