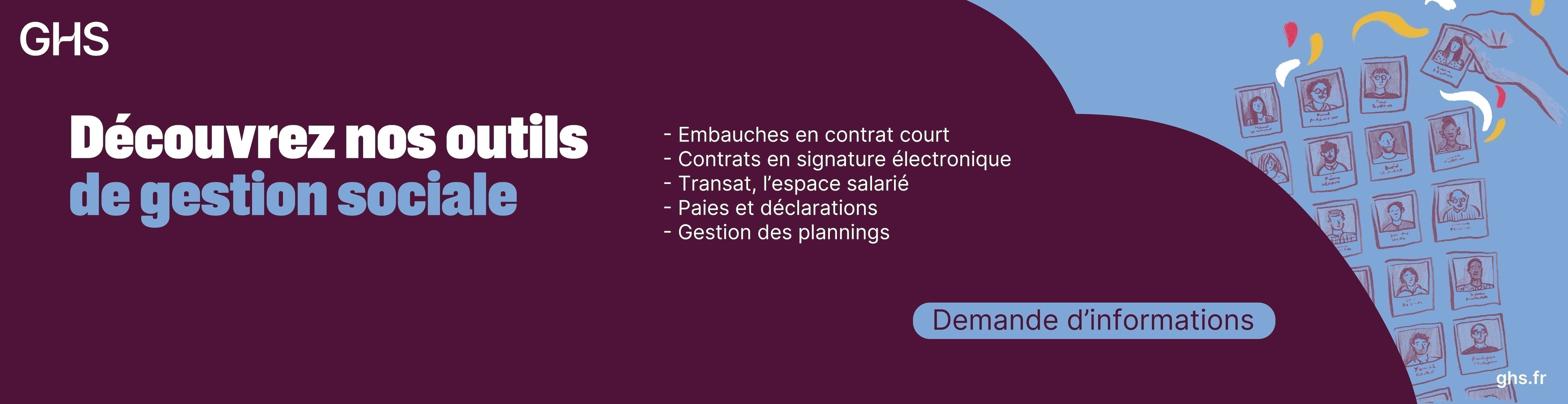Si le modèle français fait des envieux, le secteur chorégraphique se heurte aux contraintes budgétaires des lieux de spectacle, qui coproduisent moins et réduisent leur programmation. Les danseurs, eux, peinent à rester dans le système de l’intermittence.
En ces temps d’incertitude politique, le 44e festival Montpellier Danse, qui s’achèvera le 6 juillet, a invité, dimanche 23 juin, des chorégraphes et des experts en danse de pays gouvernés par l’extrême droite. Le chorégraphe Josef Nadj, formé à l’Ecole des beaux-arts de Budapest et qui a dirigé le Centre chorégraphique national d’Orléans de 1995 à 2016, avant d’établir sa compagnie à Paris, connaît bien le sort des danseurs hongrois. « Depuis que Viktor Orban est premier ministre, les subventions publiques accordées aux danseurs – considérés, à l’instar des comédiens, comme opposants au régime – ont dramatiquement fondu. Au point qu’il n’existe plus que deux alternatives pour les compagnies : arrêter de danser ou s’exiler », explique-t-il. Lui-même est fiché sur une liste noire en Hongrie et ses pièces, bannies.
Dans la même veine, Milena Dragicevic Sesic, ex-présidente de l’Université des arts de Belgrade, assure que les compagnies serbes opposées au régime s’exilent notamment en Suède. En Italie, depuis que Giorgia Meloni gouverne, les subsides accordés à la culture et à la danse se sont aussi étiolés, asséchant les finances du festival de danse RomaEuropa.
Par ailleurs, Lili Chopra, qui a vécu vingt-cinq ans à New York avant d’être nommée conseillère artistique à Chaillot-Théâtre national de la danse, a rappelé les coupes sévères effectuées dans les aides publiques accordées à la culture sous Donald Trump. Avant de rappeler à quel point « la France bénéficie d’un modèle unique au monde dans la danse et apporte aussi un soutien très important aux artistes internationaux ».
« Les périodes de répétition se réduisent »
C’est précisément ce modèle si envié qui semble vaciller, faute d’une volonté publique claire et d’une remise à niveau financière des lieux soutenus par l’Etat. Les chorégraphes s’inquiètent. « La crise est particulièrement grave, beaucoup de compagnies n’arrivent plus à payer les cachets des danseurs. Bon nombre d’entre eux redoutent de ne plus pouvoir atteindre les heures nécessaires pour rester dans le système de l’intermittence », constate la chorégraphe Mathilde Monnier, qui a dirigé le Centre national de la danse de 2014 à 2019 avant de redevenir indépendante avec sa propre compagnie. « Pour les danseurs, les périodes de répétition se réduisent, ce qui sacrifie le temps accordé à la recherche et oblige à travailler très vite », témoigne-t-elle. En ajoutant que participer à des résidences « ne rapporte même plus d’argent mais permet le plus souvent juste de couvrir les frais de logement et de voyage ».
Selon France Travail, l’Hexagone comptait, en 2022, près de 12 000 danseurs ayant signé au moins un contrat dans l’année, dont seulement 4 916 artistes chorégraphiques indemnisés par le régime des intermittents du spectacle. S’y ajoute une exception : près de 350 danseurs de ballet embauchés de façon permanente dans les opéras hexagonaux. Or, ces professionnels sont confrontés à deux handicaps : une carrière forcément courte puisqu’il est difficile de danser après 45 ans, et des salaires plus bas que ceux des comédiens. Selon la convention collective, le cachet minimal des danseurs s’élève, en 2024, à 159,56 euros par représentation et à 61 euros pour une séance de répétition.
« La casse sociale est déjà en cours », alerte Marion Gauvent, coprésidente de L’Association des professionnels de l’administration du spectacle (Lapas), qui souligne les « baisses drastiques d’activité, les conditions de travail dégradées et les perspectives de déclin budgétaire dans les années à venir ».
Tensions financières
Les professionnels de la danse se heurtent tous à des difficultés accrues pour produire un spectacle. « Les lieux n’allouent plus de sommes importantes. Réunir 180 000 euros peut prendre deux ans de travail, il faut cumuler beaucoup plus d’acteurs qui apportent des sommes moindres, allant de 5 000 à 20 000 euros », témoigne Mathilde Monnier. Sa consœur Michèle Murray, qui crée, pour le festival de Montpellier, Dancefloor avec le Ballet de Lorraine, explique la même chose : « Il faut travailler deux fois plus pour obtenir des aides financières. » Josef Nadj le confirme : « Là où trois coproducteurs suffisaient il y a vingt-cinq ans, il en faut une dizaine aujourd’hui. » S’adapter à des budgets moins florissants oblige aussi à simplifier la scénographie ou à recourir à moins de danseurs.
Ces tensions financières se répercutent, en cascade, sur les tournées. « Somnole, une chorégraphie solo, a réussi à faire près de 75 dates en trois saisons alors qu’il est beaucoup plus difficile d’organiser une longue tournée pour un spectacle beaucoup plus cher, comme 10 000 gestes avec 22 danseurs sur le plateau », témoigne Hélène Joly, directrice déléguée du projet chorégraphique Terrain, dirigé par Boris Charmatz, également directeur du Tanztheater de Wuppertal. Dans ce contexte général de restriction des moyens, même pour les compagnies ayant pignon sur rue, il faut « un temps plus long pour se financer », observe Hélène Joly.
Le producteur et diffuseur de compagnies de danse Damien Valette part « quasiment de zéro » pour chaque nouvelle création. Pour boucler les 120 000 euros du budget de How in Salts Desert Is It Possible to Blossom, le dernier spectacle de Robyn Orlin, chorégraphe sud-africaine qui vit à Berlin, il convainc six partenaires français. Les cinq danseurs et les deux musiciens ont travaillé dans un village du nord de l’Afrique du Sud, puis affiné le spectacle en résidence à Toulouse et à Marseille.
Lire la suite sur lemonde.fr