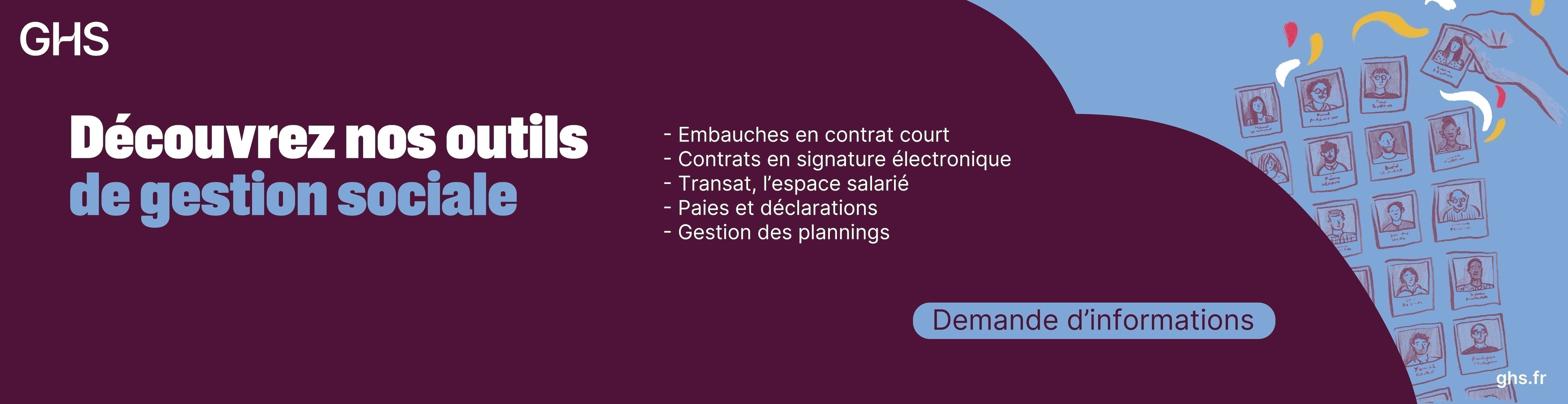Le plan « Mieux produire, mieux diffuser » de l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak avait pour ambition de favoriser la coopération entre les acteurs du spectacle vivant. Alors que la répartition des fonds tarde à arriver, où en est-on un an après son lancement ?
Quelle sera la répartition des fonds dédiés à « Mieux produire, mieux diffuser » pour 2025 ? Annoncé en 2023 par l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul Malak, ce plan, piloté par la Direction générale de la création artistique (DGCA) au ministère, vise à rendre le système plus vertueux et favoriser les mutualisations et les coopérations. Dans le viseur : le déséquilibre entre le nombre de créations et l’insuffisance de diffusion. En 2024, 254 structures (scènes labellisées et conventionnées ou réseaux de coopération) ont bénéficié des 22,2 millions d'euros du plan.
En partenariat avec les collectivités locales qui ont investi 13,5 millions d’euros, l’État s’est engagé à hauteur de « 9 millions d’euros » détaille Sophie Zeller, adjointe au directeur général à la DGCA : 22% pour la musique, 13% pour la danse, 12% pour les arts visuels ou encore 31% pour des projets pluridisciplinaires. Dans le projet de loi de finances 2025, le ministère de la Culture annonçait poursuivre avec des crédits consolidés « pour accompagner la mise en œuvre des mesures de ce plan » et déclarait renforcer « la démarche de dialogue avec les collectivités dans le cadre des contrats de territoire pour la création artistique ». Mais à ce jour, les structures bénéficiaires n’ont toujours aucune nouvelle de la répartition.
Effet catalyseur pour les « labellisés »
Après un an, quel bilan peut-on dresser ? Pour Dominique Muller, délégué à la musique à la DGCA, « les premiers effets du plan sont déjà visibles ». Sophie Zeller explique en effet, avoir des preuves du renforcement des coopérations, « par exemple par le biais de l’ONDA [L’Office national de diffusion artistique, qui encourage la diffusion des formes contemporaines de spectacle vivant, ndlr] qui conditionne désormais son soutien à un partenariat entre au minimum trois structures. Elle n’a eu aucun mal à distribuer ses aides, au contraire ».
À Rennes, ce financement a confirmé l’engagement de l’Opéra qui expérimente diverses formes de coproductions, nationales et régionales. Matthieu Rietzler, le directeur, évoque un « effet catalyseur ». « Notre opéra avait un soutien du ministère de la Culture mesuré. Avec "Mieux produire, mieux diffuser", nous avons eu une augmentation significative de financements qui confirme et valorise notre manière de penser la production et le travail déjà engagé. » Pour Céline Portes, co-présidente de Scène Ensemble et directrice exécutive du festival des Promenades musicales en Normandie, « ce plan porte aussi la question de la solidarité de la filière, c’est important dans un moment où la culture et donc l’emploi artistique sont menacés ». Seulement, pour en bénéficier, il faut être labellisé.
Signal négatif
Une condition d’attribution qui fait grincer des dents. Certains pointent le signal négatif envoyé : « D’une certaine manière, cela revient à nous dire qu’il y a trop d’artistes et que certains auraient plus la légitimité d’exister que d’autres », pointe une participante du forum Entreprendre dans la Culture qui se déroulait à Nantes début...
Lire la suite sur lalettredumusicien.fr