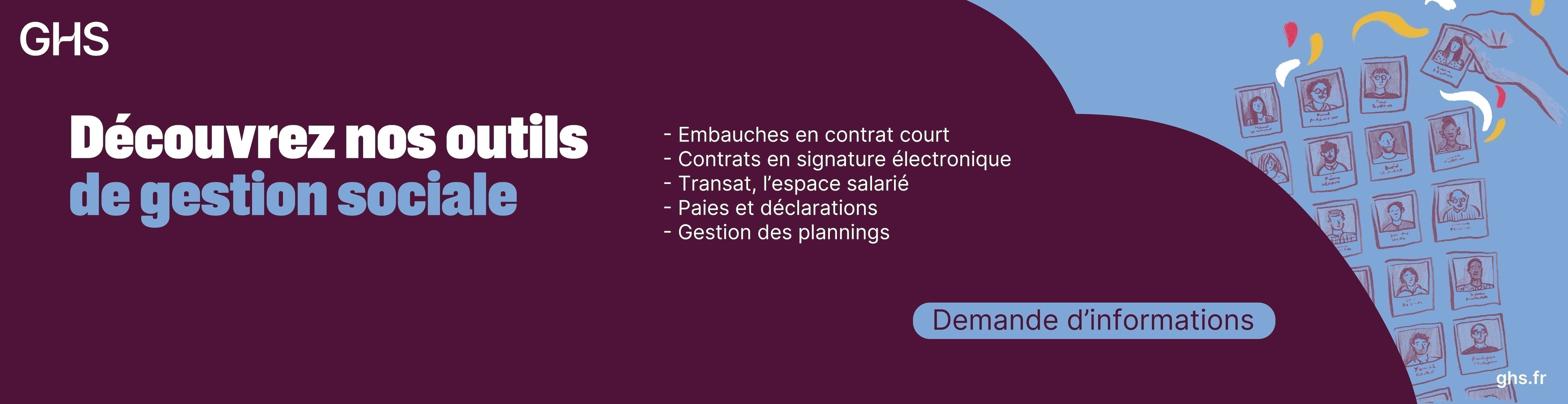ENQUÊTE - L’établissement, qui forme danseurs et chanteurs d’excellence, s’est hissé en deux ans à la quatrième place des meilleures écoles de spectacle au monde. Un saut qui ne doit rien au hasard.
Émilie Delorme est assise à son bureau. Derrière elle, un grand mur rouge. Dans ce bâtiment de 40.000 m2 dédié à la musique et à la danse que Christian de Portzamparc a livré en 1990, l’architecte a joué les ouvertures et les couleurs. Émilie Delorme en tient la barre depuis janvier 2020. Lorsqu’on lui demande comment elle a fait pour propulser en deux ans l’établissement du 17e au 4e rang du classement mondial des meilleures écoles de spectacle du monde, cette femme avenante, qui n’a pas encore 50 ans, désigne un grand tableau de liège sur sa droite.
Sur le dessus est piqué un ensemble de pages rythmées de surlignages. Elle rit: «C’est le projet d’établissement. On le fait avancer par un travail quotidien mené avec les 21 personnes qui dirigent les dix départements du conservatoire, dédiés à la musique ancienne ou vocale, au jazz, aux disciplines instrumentales classiques et contemporaines comme à composition, la musicologie, ou les notations Laban ou Benesh. Toutes les initiatives à mener sont listées ici sur ce tableau. Lorsque j’ai pris mes fonctions en janvier 2020, le CNSMD (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) venait de connaître une vacance de direction de six mois. J’ai trouvé cependant une maison très énergique en demande d’un cap où aller et de décisions à prendre. Je n’ai pas eu longtemps à me demander si elle allait suivre. Il a plutôt fallu séquencer les choses pour ne pas aller plus vite que la musique.»
Depuis son arrivée en janvier 2020, Émilie Delorme n’a pas mesuré ses efforts. «Imaginez! Un lieu où on donne 370 représentations par an! Et qui abrite 1400 élèves. C’est un des plus beaux métiers de s’occuper de jeunes artistes», dit-elle. Venant du festival d’art lyrique d’Aix, où elle s’occupait des jeunes talents, la directrice dit avoir travaillé sans cesse avec des musiciens issus du Conservatoire. Celui-ci, fort de ses 227 ans d’histoire et de sa pratique continue du dialogue avec les créateurs de son temps, structure la vie musicale et chorégraphique française. Restait cependant à orchestrer la musique.
Un teasing pour l’oreille
Le classement mondial s’effectue sur trois critères: la réputation académique, la réputation professionnelle et la dynamique de recherche. Sans viser particulièrement le grand bond en avant, Émilie Delorme a spécialement soigné les deux derniers volets. Le premier allait de soi. Le conservatoire dispose de 6000 instruments, anciens et modernes, dont 250 pianos que les accordeurs vérifient chaque matin à 7 heures avant le début des cours. En outre, l’enseignement s’inscrit dans l’excellence. Il est dispensé par 400 artistes de renom, pour la plupart toujours inscrits dans la vie professionnelle.
Arpenter les couloirs un matin est un teasing pour l’oreille. Des bribes de notes volent dans l’espace. En approchant, par la petite fenêtre pratiquée dans les portes, on voit les élèves au travail. Ici, une jeune femme entourée de deux professeurs et d’une pianiste. Clémence Danvy, soprano, prépare son prix de conservatoire, celui qui se décerne à la sortie. «Pourquoi ai-je choisi de chanterLucia di Lammermoor? Parce que c’est mon opéra préféré, dit cette jolie brune dont la voix impressionne. Je chanterai aussi Despina, Manon, et Ãanchen duFreischütz. C’est mon répertoire. L’idée est de se faire plaisir avec un récital public de 50 minutes, le 13 juin.» Le moment est émouvant: c’est ici que l’on cueille les talents tout juste éclos.
Dans le studio, rien n’est laissé au hasard. À côté d’Élène Golgevit, chanteuse soliste et professeur de chant qui travaille avec Sabine Devieilhe ou Julie Fuchs, le professeur de diction lyrique italienne intervient à chaque phrase, reprenant la césure d’un mot, l’ouverture d’une voyelle. «Nous sommes deux sopranos à sortir du conservatoire cette année. On nous a fait rencontrer un certain nombre de professionnels ; ils sont venus ici échanger avec nous. Alexander Neef, directeur de l’Opéra de Paris, par exemple, nous a donné des conseils pour les auditions que nous devrons passer.“Ce qui tue une audition, nous a-t-il dit, c’est l’ambition”. Je suis assez d’accord avec lui: mieux vaut choisir un morceau court et que l’on sait bien faire plutôt que de céder à la tentation de vouloir impressionner. De toutes les façons, on sait bien qu’en sortant, on commencera par des petits rôles.»
Une calamité puis une aubaine
Dans la salle d’orgue, Thierry Escaich travaille dans une salle inspirée du Panthéon avec voûte à caissons et oculus ouvert sur le ciel de printemps. Compositeur et professeur d’orgue, il se tient au piano, et son élève à son buffet d’orgue. Les expressions imagées fusent. «Faites la même bourrasque mais avec un arpège», dit-il en reprenant son élève. Et encore: «Ça peut être plus concluant. Mettez un flux, une force, un drame. Ça n’est pas un galop second Empire! Imposez votre musique. Posez les temps, là vous les fuyez !» Le résultat se façonne peu à peu. Particularité du CNSMD, une petite salle tout en longueur est réservée aux ondes Martenot. Une jeune Coréenne l’a réservée pour deux jours. Elle travaille son morceau sur le clavier posé dos à un ensemble de récepteurs de formes diverses.
Le format des salles s’agrandit pour les studios de danse dont les baies vitrées regardent sur la Grande Halle de la Villette. Cédric Andrieux, un temps interprète chez Merce Cunningham, a pris la direction de la danse, qui regroupe 120 élèves. Cheryl Therrien, interprète également chez Cunningham, a posé devant elle un lot de dés. Elle les joue pour tirer au sort les différentes combinaisons possibles d’un trio de danseurs contemporains. Plus tôt dans l’année, les élèves ont donné à la Villette une interprétation impressionnante de pièces de Trisha Brown transposées pour la centaine d’élèves.
«Je suis arrivée en janvier 2020. Deux mois après, le Covid obligeait à tirer le rideau», se souvient Émilie Delorme, qui a su tirer un effet d’aubaine à partir d’une calamité. «Tout de suite, il a fallu se mettre dans un travail quotidien et opérationnel. On a commencé à travailler pour l’après en traitant l’un après l’autre les effets de la crise. D’emblée, il a fallu créer un environnement sain, bienveillant, sécurisé et créatif. Remédier à la précarité étudiante. Travailler plus que jamais à l’insertion professionnelle. Et bien sûr accélérer la transition numérique de l’établissement: les captations sont un moyen de faire ce métier.»
Favoriser l’insertion professionnelle
Pour favoriser l’insertion professionnelle, les liens avec le milieu ont été resserrés. Dans tous les sens possibles et imaginables. Avec les partenaires historiques comme la Philharmonie, l’Opéra de Paris, l’Opéra Comique, les ballets et les centres chorégraphiques nationaux où les danseurs partent en stage, l’Orchestre de chambre de Paris ou Radio France pour permettre aux étudiants de jouer au sein de l’orchestre. «Nous avons aussi fait une base de données de nos diplômés récents. Très utile en période de Covid où la maladie conjuguée à la fermeture des frontières a permis à nos musiciens de faire maints remplacements», poursuit la directrice.
Parallèlement, les divers services de la maison mettent leurs compétences au service des étudiants. Beaucoup aujourd’hui sont désireux de créer leur ensemble. Le Balcon, par exemple, est né en 2008 de l’initiative de six étudiants sortis du CNSMD. Sur le même modèle, la jeune chef d’orchestre Clara Baget vient de créer les Éclats. «On essaie de l’accompagner, en mettant à sa disposition une salle où répéter, en lui donnant les moyens pour enregistrer, en lui prodiguant des conseils si elle le souhaite pour la communication, la production», souligne la directrice. Qui a aussi retendu les liens avec le réseau. Celui des conservatoires de région et de département, les élèves peuvent venir assister au cours pour juger du niveau, et le CNSMD a ouvert un cycle supérieur de formation musicale pour encourager les postulants - on en manque - au certificat d’aptitude à enseigner en CRR et CRD. Les liens avec les écoles de recherche ont aussi été revus, avec une équipe spéciale dédiée et des partenariats renforcés avec les grandes écoles d’art, le CNRS et Normale Sup.
Pour le numérique, Émilie Delorme a vu grand: la création d’un Conservatoire augmenté, plateforme pédagogique pour mieux partager les ressources avec l’ensemble de la filière...
Lire la suite sur lefigaro.fr