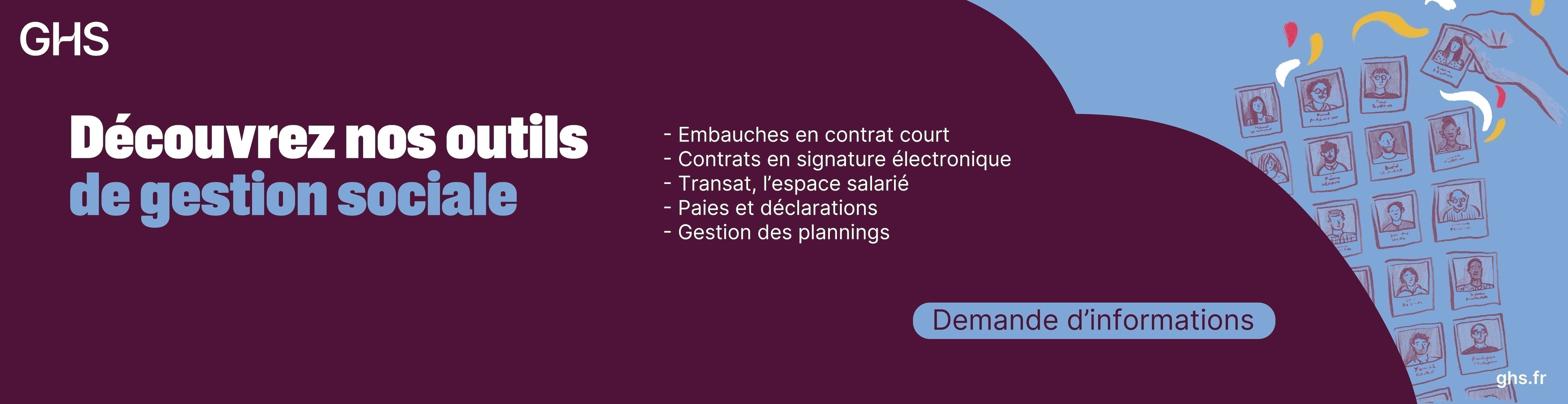ENQUÊTE. Concurrencé par Netflix et les autres offres de streaming, malmené pendant la pandémie, le septième art se porte mal. Pour faire revenir les spectateurs dans les salles obscures, il va devoir se réinventer en profondeur.
Chaque matin à son réveil, le cinéma se demande s’il est encore en vie. La réponse n’est jamais la même. Le triomphe planétaire de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (450 millions de dollars de recettes en un week-end, début mai, soit environ 426 millions d’euros) confirme, après le succès de The Batman, que les adolescents de tous âges sont toujours disposés à emplir les salles qui leur proposent des super-héros familiers. Six semaines plus tôt, l’échec d’Ambulance, de Michael Bay, ci-devant roi du box-office, qui devait cette fois se contenter de 50 millions de dollars de recettes, sonnait, pour les analystes américains, le glas du film d’action sur grand écran, le genre ayant été préempté par les plates-formes de streaming, qui sont devenues les premiers employeurs des acteurs spécialistes du genre comme Mark Wahlberg ou Charlize Theron.
En France, il manque toujours aux salles entre un quart et un tiers des spectateurs par rapport à l’avant-pandémie : ils étaient 13,9 millions en avril 2022, contre 18,05 millions trois ans plus tôt. Bien sûr, la part de marché du cinéma français s’est envolée, à 49,2 % sur les quatre premiers mois de l’année 2022, pendant que le cinéma américain s’effondrait, passant de 55,7 % en 2019 à 27,3 % sur cette période. Mais, parmi les quatre-vingts films ayant rencontré le plus de succès au cours de l’année écoulée, selon le classement établi par l’hebdomadaire professionnel Le Film français, deux seulement, En corps, de Cédric Klapisch, et Un autre monde, de Stéphane Brizé, relèvent du cinéma d’auteur. Les recettes sont allées aux itérations de franchises comiques, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? (Philippe de Chauveron), Les Tuche (Olivier Baroux), Kaamelott (Alexandre Astier), et à BAC Nord (Cédric Jimenez).
Quant aux films américains, le rétrécissement de leur audience s’explique avant tout par la raréfaction des sorties en salle. Les grands studios, à commencer par le plus grand d’entre eux, Disney, ont des plates-formes à alimenter et préfèrent leur réserver les longs-métrages qu’ils présentent ou acquièrent dans les festivals. En France, ce phénomène a pour conséquence d’appauvrir la production locale, qui était en partie financée par la taxe sur les entrées en salle à laquelle contribuaient, sans en bénéficier, les productions hollywoodiennes.
Mécènes munificents
Mais, au moment où le triomphe des plates-formes, qu’elles soient issues de l’univers de la tech (Netflix, Amazon Prime Video, AppleTV+) ou de la mutation des studios (Disney+, HBO Max…), semblait aussi inéluctable que celui des zombies dans un film de George Romero, il a suffi que Netflix perde 200 000 abonnés (sur 222 millions, une baisse en partie due à l’abandon du marché russe) pour que l’on discerne, dans ce premier recul, l’échec du modèle industriel défendu par ses dirigeants, Reed Hastings et Ted Sarandos, qui ont toujours vu dans la salle de cinéma un simple moyen de promotion pour des « contenus » à consommer sur les écrans domestiques. Confrontée à la nécessité d’économies drastiques, la plate-forme pourra-t-elle, voudra-t-elle, rester le mécène munificent qui a financé The Irishman, de Martin Scorsese, pour un budget qui est d’ordinaire celui d’un film Marvel ? Pour l’instant, la réponse reste oui. Il y a une quinzaine de jours, Netflix annonçait l’acquisition, pour le monde entier, de Bardo, le prochain long-métrage d’Alejandro Gonzalez Iñarritu, la plate-forme jurant que le film sortirait partout en salle.
Face à ce flux ininterrompu d’informations contradictoires, les rituels du cinéma qui, bon an, mal an, servaient de points de repère, deviennent à leur tour la source d’interrogations sans fin. La gifle assénée par Will Smith à Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars, le 27 mars, a occulté un autre coup, celui porté aux réalisateurs. Plutôt que de couronner Jane Campion, autrice reconnue, qui avait fait la course en tête, pour un film sorti sur Netflix, mais de toute évidence destiné au grand écran, The Power of the Dog, les professionnels du cinéma américain ont préféré décerner l’Oscar du meilleur film à CODA, de Sian Heder, remake américain de La Famille Bélier (Eric Lartigau) que ses producteurs français avaient vendu à une autre plate-forme, AppleTV+. Film familial dépourvu de dimension spectaculaire, CODA ressemble beaucoup au prototype de ces œuvres que l’on a appris à consommer chez soi pendant le confinement.
A l’instar des Oscars, le Festival de Cannes, dont la 75e édition s’ouvre le 17 mai, apportera quelques réponses et posera de nouvelles questions. Comme il l’a déjà fait par le passé, son délégué général, Thierry Frémaux, officialisera l’existence d’une porosité entre le monde de la salle et celui des séries, en projetant les trois premiers épisodes d’Irma Vep, la série qu’Olivier Assayas a réalisée pour HBO Max. Assayas, qui s’est déjà essayé au format avec Carlos, en 2010, est l’un des innombrables auteurs de cinéma à alimenter les plates-formes en fictions épisodiques. Jane Campion, Barry Jenkins, Bruno Dumont, David Fincher, Arnaud Desplechin, ont élargi le sentier jadis tracé par Ingmar Bergman (Scènes de la vie conjugale, Fanny et Alexandre), Maurice Pialat (La Maison des bois) ou Rainer Werner Fassbinder (Berlin Alexanderplatz).
Mais, face à l’opposition des exploitants de cinéma, représentés au sein du conseil d’administration du Festival, Thierry Frémaux n’a pu amender la règle qui veut qu’un film ne peut concourir pour la Palme d’or que si sa sortie en salle est garantie – ce qui exclut, pour l’instant, les films Netflix. La plate-forme a beau avoir adhéré à la nouvelle version de la chronologie des médias adoptée en France, elle n’est pas prête à laisser s’écouler quinze mois entre le moment où l’une de ses productions serait présentée sur la Croisette et celui où elle sera en mesure de la proposer à ses abonnés. Reste aussi à savoir si le sort des films en compétition cette année sera meilleur que celui des films de l’édition 2021 qui avait été décalée au mois de juillet. Comme beaucoup de films d’auteur, nombre de longs-métrages cannois présentés lors de la 74e édition n’ont pas rencontré leur public traditionnel, celui des cinéphiles de plus de 50 ans.
Nouveau départ
A-t-il déserté ? Pour l’instant, les statistiques du Centre national de la cinématographie ne permettent pas de le confirmer, qui situent la part des seniors à 39,6 % du marché en mars 2022, contre 43 % trois ans plus tôt. Mais c’est pour ces « têtes blanches », que l’on soupçonne d’avoir appris à se servir des nouvelles télécommandes, celles qui arborent des touches Netflix, Prime Video ou Disney+, pendant les confinements, que le cinéma d’auteur a vécu ces dernières décennies. Leur éventuel effacement peut être perçu aussi bien comme une désertion que comme l’occasion d’un nouveau départ.
On peut résumer cette gigantesque somme d’incertitudes en une expression triviale : le cinéma ne sait plus où il habite : dans les salles ou dans les salons ?
Dans la salle de montage parisienne où il met la dernière main à Irma Vep, variation sur le thème du long-métrage qu’il a réalisé, en 1996, pour « zéro franc, zéro centime », Olivier Assayas est résolu à tirer le meilleur parti de « cette période de mutation inachevée ». Il y voit l’occasion de « faire sauter les verrous. Par exemple, la durée des films a toujours été l’un des enjeux de conflit au sein du cinéma ». « Si tu dépassais une heure cinquante c’était un problème, si tu dépassais deux heures vingt, c’était un problème. Conflit classique, traditionnel entre producteurs, distributeurs et réalisateurs. Aujourd’hui, si tu as envie de raconter une histoire qui dure longtemps, il y a la possibilité de le faire d’une façon qui ne te met pas dans des conflits impossibles avec les partenaires, parce que ce qui intéresse les plates-formes, c’est le flux. Pour eux, plus il y en a, mieux c’est, à condition que ça marche un peu », explique Olivier Assayas. Il définit Irma Vep comme « un film de huit heures » que HBO lui a permis de réaliser dans des conditions matérielles infiniment plus confortables que celles qui avaient entouré le long-métrage de 1996.
Katell Quillévéré, la réalisatrice des longs-métrages Suzanne et Réparer les Vivants, et Hélier Cisterne, auteur de cinéma (Vandal, De nos frères blessés), mais aussi réalisateur dans l’équipe d’Eric Rochant pour la série Le Bureau des légendes, ont dirigé à quatre mains ce qu’ils estiment être « peut-être [leur] meilleur film ». Chronique en six épisodes de la naissance du hip-hop en France, Le Monde de demain sera diffusé en octobre, sur Arte. A peine quadragénaires, Quillévéré et Cisterne sont d’une génération dont la cinéphilie est nourrie aussi bien de The Wire que de La Maman et la putain : « On ne se dit pas qu’un endroit fait œuvre et pas un autre », dit la réalisatrice. Pour réaliser Le Monde de demain, le duo a travaillé avec un producteur de cinéma, Justin Taurand, et une chaîne, Arte. Celle-ci leur a demandé à qui s’adressait leur histoire. « C’est une question qui nous passionnait, dit Katell Quillévéré. Quand j’ai commencé à faire des longs-métrages, je n’en avais aucune conscience, j’étais seulement habitée par la nécessité de l’histoire. La question du public est arrivée avec une forme de maturité, elle est devenue essentielle. » Hélier Cisterne renchérit : « Le cinéma d’auteur s’est petit à petit tourné vers les têtes blanches, sans qu’on se pose la question frontalement. » « On entend souvent les distributeurs dire qu’ils ne savent pas sortir des films destinés à la jeunesse », ajoute sa compagne.
Une analyse que partage Olivier Assayas : « Le désir d’aller au cinéma restera, en particulier pour les ados, parce que c’est la distraction la moins chère. Mais ce sera beaucoup plus délicat pour le cinéma indépendant. Son public a vieilli. Il s’est constitué autour de la Nouvelle Vague et les succès qu’il génère sont des succès « Carte Vermeil », pas très sexy. Les jeunes ne vont pas voir le film qui a eu l’Ours d’or à Berlin. Plus à la marge, il y a la zone du cinéma indépendant plus radical, qui continue à avoir une aura plus positive pour un groupe jeune et branché qui représente peu de chose en termes d’entrées, et qui passe mal auprès des plates-formes ».
Aura vieillotte
Il est arrivé, ces dernières années, que les obstacles que décrit Olivier Assayas disparaissent sur le chemin d’un film d’auteur : ce fut le cas, et de manière spectaculaire, avant la pandémie, de Parasite, de Bong Joon-ho, film coréen, Palme d’or à Cannes, Oscar du meilleur film. Deux ans et quelques confinements plus tard, toujours à Cannes, la décision du jury, dirigé par Spike Lee, de décerner la plus haute récompense à Titane, de Julia Ducournau, témoignait du souci d’abolir la distance entre le jeune public du cinéma de genre et l’aura désormais vieillotte du cinéma d’auteur. Ces dernières semaines, l’impressionnant succès en salle, aux Etats-Unis, d’Everything Everywhere All at Once, de Dan Kwan et Daniel Scheinert, film qui adapte l’idée de multivers (en usage dans les franchises de super-héros, selon laquelle il existerait plusieurs univers parallèles) au langage du cinéma indépendant, a même démontré qu’un long-métrage produit hors des studios pouvait encore exister sans les plates-formes. Le phénomène reste exceptionnel, et la plupart des films salués au Festival de Sundance, en janvier, comme les longs-métrages d’horreur Fresh, de Mimi Cave, ou Master, de Mariama Diallo, ont été immédiatement happés, respectivement par Disney+ et Prime Video.
Fondatrice et dirigeante, avec Carole Scotta, de Haut et court, société qui produit, distribue et exploite des longs-métrages en salle, Caroline Benjo fut la première figure du cinéma indépendant français à produire une série, Xanadu, en 2011. Depuis, elle a contribué à la naissance des Revenants, de The Young Pope ou de No Man’s Land. C’est elle, la transfuge, qui entrevoit les limites de cette migration des créateurs du cinéma vers les séries et les plates-formes : « Ces dernières années, on observe, et de façon encore plus notable depuis la pandémie, une sorte de bulle spéculative autour de la télévision, avec des quantités d’argent qui semblent sans limite, des projets en veux-tu en voilà, et une sorte de normalisation, d’industrialisation qui fait qu’on s’éloigne plus qu’on se rapproche du grand âge de la télévision ». Elle poursuit : « Pour les plates-formes, il s’agit de produire vite et beaucoup, la nouveauté prend nécessairement le pas sur la qualité (…), la cinéphilie fondée sur des films que tu voyais en salle avant de les redécouvrir à la télévision ou d’en acheter les DVD, c’est fini, il n’y a plus de circulation des œuvres. »
Pour la productrice, les méthodes de certaines plates-formes qui s’adressent directement aux créateurs (réalisateurs de cinéma, showrunners de séries) « déséquilibrent très profondément un écosystème vertueux qui a prouvé son efficacité et a su faire émerger les plus grands talents. Il y a pléthore d’argent, les moyens sont là, mais, force est de constater, les films de plate-forme des grands réalisateurs ne sont pas leurs meilleurs. »
Splendeur passée
Le cinéma en salle, qui propose des œuvres aux contours fixes (on n’est jamais sûr qu’une série soit tout à fait finie) est devenu un objet qu’il s’agit de rénover ou de préserver, que l’on veuille l’inscrire définitivement dans l’univers que construisent les barons de la tech, comme le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, ou celui d’Amazon, Jeff Bezos, ou que l’on veuille lui rendre sa splendeur passée.
Pour certains, il s’agit avant tout...
Lire la suite sur lemonde.fr