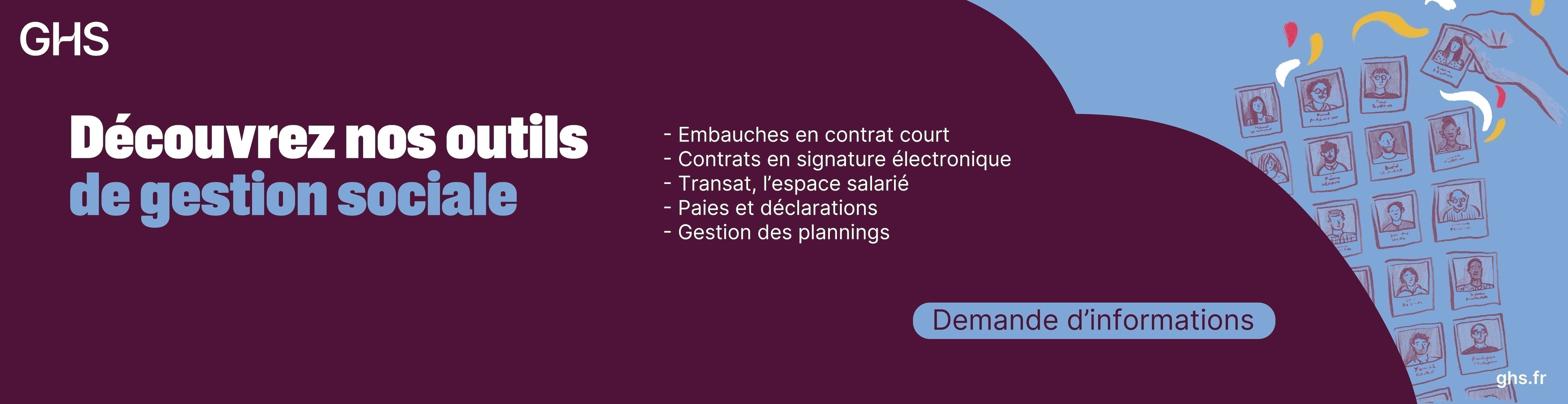Au plus bas niveau depuis quarante ans et après 2020, l’industrie du 7ᵉ art se cherche des boucs émissaires.
Le 3 octobre, un rapport du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) révélait que la fréquentation des salles de cinéma, au mois de septembre 2022, avait atteint un seuil critique avec 7,38 millions d’entrées, soit le plus bas niveau depuis la réouverture des salles, le 18 mai 2021, à l’issue d’une année de pandémie. La douche s’est révélée d’autant plus froide que le secteur comptait beaucoup sur l’« effet rentrée » à la suite d’un été en berne. A l’exception de l’année 2020, celle de la crise sanitaire et de la fermeture des lieux de culture, de tels résultats n’avaient pas été enregistrés depuis 1980.
Les causes de cette désaffection des salles ont beau être multiples, on n’en entend pas moins régulièrement une petite musique lancinante qui résonne comme une recherche de coupables et en appelle à la vox populi. « Les spectateurs n’ont pas envie d’aller au cinéma pour se faire chier », s’est ainsi écrié Jérôme Seydoux, le patron du groupe Pathé, au micro de France Inter, mercredi 12 octobre, mettant explicitement sur la sellette, si l’on peut dire, le cinéma d’auteur français. On ne saurait être plus loin de Martin Scorsese, qui a déclaré, le 13 octobre, sur la scène du New York Film Festival : « Depuis les années 1980, on ne regarde plus que les chiffres. (…) Le cinéma est dévalué, déconsidéré, amoindri de toutes parts, non pas tant sa part commerciale qu’artistique. »
Régulation et multiplexe
On l’a compris, c’est bien cette part que le modèle protectionniste français, en cela longtemps exemplaire, a sanctuarisée et soustraite aux obligations du marché, le cinéma dit « d’auteur », ou, selon un label bien connu, l’« art et essai », qui serait coupable de ne pas divertir le grand public et de gâcher la fête avec des sujets qui fâchent. Pointé du doigt, jugé soudain au nom de la rentabilité jusqu’au sein de ces instances, on sent bien que ses relations avec les pouvoirs publics, comme avec les autorités de tutelle, se sont tendues depuis quelques années, comme en témoigne le récent appel à des Etats généraux du cinéma.
Il faut, aussi bien, revenir en arrière, pour mieux comprendre l’inquiétude qui s’exprime aujourd’hui. La précédente « crise du cinéma », en 1980, liée au développement du marché de la vidéocassette et de la périurbanisation des publics, avait conduit, au fil de la décennie, à la fermeture de nombreuses salles des centres-villes, dites « de quartier ». Face à ces nouveaux acteurs déplaçant l’usage des films dans la sphère privée, des réponses avaient été très vite apportées grâce à une concertation entre professionnels et pouvoirs publics. La première d’entre elles fut la régulation. Elle aboutit à la loi du 29 juillet 1982, inaugurant un édifice législatif bientôt connu sous le nom de « chronologie des médias ». Chaque diffuseur disposant alors d’une fenêtre dans un parcours privilégiant la salle, à qui est réservée la première exclusivité. Le secteur, de son côté, n’a pas tardé à engager de vastes restructurations qui ont pris la forme, dans les années 1990, d’un nouveau modèle de concentration des écrans : le multiplexe, calé sur les standards de la grande distribution et les nouveaux usages de la ville.
Le cinéma dit « d’auteur » serait coupable de ne pas divertir le grand public et de gâcher la fête avec des sujets qui fâchent
Simultanément, dans ces années 1980, l’essor de la télévision, qui faisait alors largement appel à la diffusion de films de cinéma (en particulier avec la création de la chaîne payante Canal+) avait entraîné une baisse de la fréquentation des salles, conduisant les pouvoirs publics à redéfinir des règles du jeu et à créer, par la loi de finances pour 1984, une taxe sur les ressources des chaînes venant alimenter le compte de soutien du CNC. Avec l’arrivée de l’Internet à haut débit, au début des années 2000, la fidélisation d’un public en salle passe par une nouvelle formule, celle des cartes d’abonnement illimité.
Succès des plates-formes
Quoi qu’on en dise, c’est grâce à ces mesures que la salle de cinéma en France est restée un lieu incontournable de la cinéphilie, la fréquentation atteignant un record en 2019 avec 213 millions d’entrées – même si déjà la concurrence des plates-formes s’annonçait comme la prochaine bataille à mener. L’originalité du dispositif du CNC est enviée dans le monde entier – le Korean Film Council (Kofic), en Corée du Sud, est ainsi directement inspiré du modèle français. Son soutien est essentiellement financé par les contributions des entreprises (établissements cinématographiques, chaînes de télévision, éditeurs vidéo…), par les plates-formes depuis le décret SMAD (services de médias audiovisuels à la demande) du 1er juillet 2021, enfin par les spectateurs en salle – lesquels payent une taxe sur le billet (dite « TSA ») représentant 11 % de son prix.
Mais le succès des plates-formes, qui n’ont eu qu’à « dérouler le tapis » pendant la fermeture des salles – trois cents jours, du 15 mars au 21 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 –, a contribué à façonner de nouveaux usages : le visionnage à domicile, peu onéreux grâce aux abonnements, a fait du cinéma un luxe, les spectateurs ayant moins recours, de fait, aux cartes illimitées. Certaines catégories d’âge, mises en danger par la pandémie, ne sont, par ailleurs, pas totalement revenues dans les salles.
Dans ce contexte, il est vrai que le cinéma d’auteur – qui englobe des réalités multiples, depuis les films dits « du milieu » jusqu’au cinéma de recherche – se retrouve le plus sévèrement touché par la baisse de fréquentation. Sans doute n’est-il pas exempt d’un certain nombre d’effets pervers suscités par le système de soutien, à commencer par le nombre de films produits et un certain formatage esthétique. C’est pourtant grâce à ce système que fleurit la diversité unique au monde de notre cinéma (qui soutient aussi les auteurs partout dans le monde) et que naissent des œuvres d’une très haute tenue artistique. En tout état de cause, l’industrie du cinéma n’a jamais engagé que des prototypes. Il en allait déjà ainsi à Hollywood, qui produisait, dans les années 1930 et 1940, cinq cents films par an, dont seule une minorité était rentable.
Le visionnage à domicile, peu onéreux grâce aux abonnements des plate-formes, a fait du cinéma un luxe
A ce titre, le cinéma d’auteur est certes en difficulté, mais, à l’exception d’une poignée de locomotives américaines, il n’est pas le seul. Rumba la vie, le dernier produit-phare de Gaumont au rayon comédie avec Franck Dubosc, plafonne à 283 000 entrées, moins que les films d’auteur Revoir Paris, d’Alice Winocour, qui vient de dépasser les 450 000 entrées, ou La Nuit du 12, de Dominik Moll (plus de 500 000). Pour un succès surprise comme BAC nord (2 200 000 entrées), combien de Canailles (comédie UGC avec José Garcia et François Cluzet, 52 000 entrées) ou de La Très Très Grande Classe (comédie écolière avec Audrey Fleurot, 379 000 entrées) ? Ainsi les têtes de gondole du marché ne sont-elles pas exemptes des reproches et d’un climat de banqueroute que l’on fait peser sur les seules épaules du cinéma d’auteur.
« La grande fabrique de l’image »
Avant de pronostiquer la mort prochaine du cinéma en salles, que certains s’empressent de claironner, posons donc deux questions essentielles : peut-on demander à une industrie soumise à des turbulences sans précédent de se remettre sur pied du jour au lendemain, faute de quoi elle serait condamnée à terme ? Surtout, quelles sont les pistes sérieuses qui ont été explorées pour que l’essor des plates-formes ne se fasse pas au détriment de la salle et des films d’auteur ?
Pour l’heure, le seul appel à projets lancé par le gouvernement est celui de...
Lire la suite sur lemonde.fr