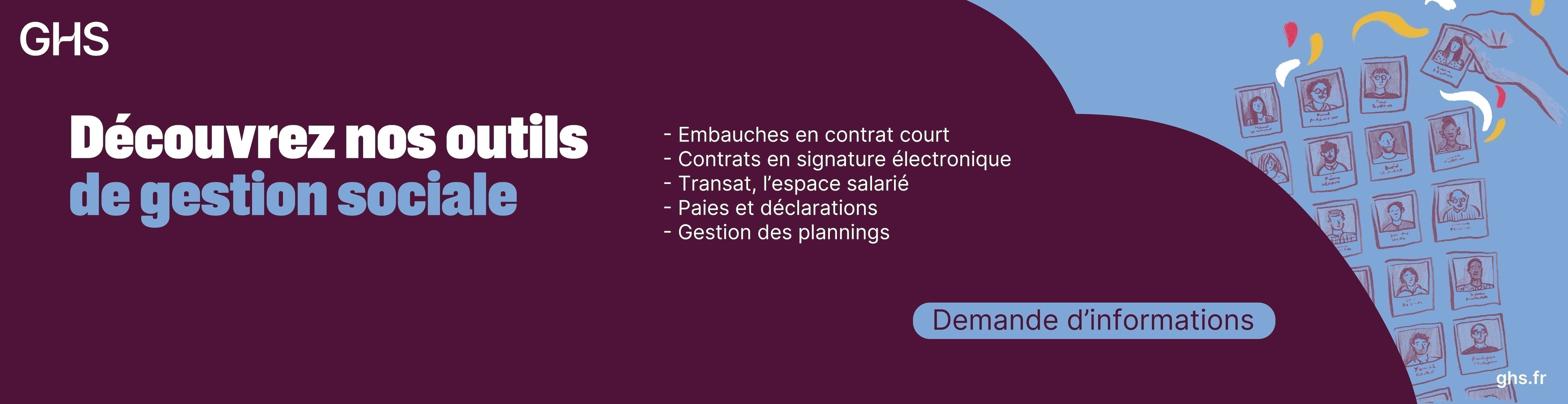Les institutions culturelles sont confrontées depuis quelques temps à des enjeux que l’épidémie de coronavirus a rendus plus aigus encore. Alors même que le confinement a suscité une forte demande de culture, beaucoup de ces institutions sont aujourd’hui face à un tournant.
Dans « La crise de la culture », Hannah Arendt distingue une culture de masse qui, selon elle, n’existe pas et un « loisir de masse » qui se nourrit des objets culturels du monde. Elle assène : « Croire qu’une telle société deviendra plus “cultivée” avec le temps et le travail de l’éducation est une erreur fatale1. »
La dernière enquête décennale sur les pratiques culturelles des Français, commandée par le ministère de la Culture, si elle constate un appétit accru, nous alerte sur les changements au long cours amorcés avant la crise : recul de la lecture, vieillissement des publics du cinéma, du théâtre, de la danse et de la musique classique, baisse de la pratique amateur et de la consommation de la télévision. En revanche, l’écoute de musique en ligne, la fréquentation des contenus numériques et la pratique du jeu vidéo par les plus jeunes sont en constante augmentation2. La grande crise mondiale que nous traversons conforte ainsi une partie du diagnostic de Hannah Arendt – le loisir de masse s’est bien approprié « les objets culturels du monde » à un niveau jamais atteint jusqu’alors –, mais certains signes nous rendent, au cœur de la catastrophe, plus optimistes que la philosophe.
Depuis plus de trente ans, l’acception du mot « culture » n’a cessé de s’élargir, faisant craindre à certains la perte de son « aura » ou sa dilution dans le marché. Aujourd’hui, le rap est ainsi devenu la première musique consommée dans le monde. L’univers des séries a bien rejoint celui du cinéma comme lieu de référence de l’écriture visuelle et de l’invention scénaristique. Cet univers a d’ailleurs profité du confinement généralisé pour prospérer. N’était-ce là que du divertissement pour nous faire oublier notre peur ? Que restera-t-il de ces dizaines d’heures à avaler à la file des « saisons » de Sex Education, La Casa de Papel ou Le Bureau des légendes ? Nul ne peut le dire, mais n’y a-t-il pas dans le très décrié binge watching l’une des conditions premières de l’art ? Pour les générations précédentes de cinéastes, la fréquentation assidue des cinémathèques puis l’usage compulsif des premières vidéothèques leur ont permis d’aiguiser leur regard et de se souvenir d’un plan, d’un visage, d’une expression pour nourrir une œuvre originale. Citer, c’est s’inscrire dans le fil du temps, comme les rappeurs le font depuis des décennies en reprenant un riff de guitare ou un mouvement de violon (sampling).
Privés de l’essentiel
L’arrêt du monde que nous avons vécu a montré comment créateurs et artistes ont su non seulement s’adapter à la contrainte, mais inventer. Le photographe italien Gabriele Galimberti, confiné à Milan, a ainsi su tirer parti de la contrainte du confinement pour sa série Inside Out, dans laquelle il a photographié à distance des Milanais, seuls ou en famille, derrière leur fenêtre, depuis la rue, la cour ou le jardin. Pris de loin, dans la lumière tombante du jour, éclairés dans leurs intérieurs, ils auraient pu traduire la clôture obligatoire, alors que ces portraits sont une variante moderne du thème du « doux foyer » qui protège ceux qui en possèdent un.
L’arrêt du monde que nous avons vécu a montré comment créateurs et artistes ont su non seulement s’adapter à la contrainte, mais inventer.
Martin Argyroglo, lui aussi, a transformé momentanément son travail en jouant de la position de son appartement, dans une tour de la place des Fêtes à Paris. En plein confinement, il s’est mis à photographier « du privé vers le privé ». Dans Fenêtres sur tour, il s’est servi d’un téléobjectif auparavant négligé, pour « s’affranchir de la distanciation sociale et saisir des instants de vie dans le décor minéral, bétonné et brutaliste » de ce quartier typique de l’urbanisme des années 1970 et 1980. Saisis de haut sur le trottoir ou de face dans les appartements de la tour voisine, cette série nous rappelle que l’architecture n’est belle que peuplée d’êtres humains au service desquels elle se tient.
Bien sûr, tous les domaines de la culture n’ont pu tirer un parti, même temporaire, de cet arrêt forcé. Le spectacle vivant a été particulièrement touché. Postillons des chanteurs et instruments à vent ont semblé parfois devenir des armes par destination, contraignant à l’arrêt des répétitions et concerts. Il a fallu envisager, pour les assurances et pour protéger ses partenaires de jeu, des tests et des normes nouvelles afin de redonner vie aux espaces clos des salles de concert et des théâtres. Et ce ne sont pas les captations de pièces et de spectacles qui ont pu remplacer la présence réelle des acteurs et des musiciens. Le futur directeur de l’Opéra de Paris, Alexander Neef, souligne que « dans un monde où l’on nous dit de plus en plus ce qu’il faut penser, on peut – on doit – face aux arts vivants, avoir une opinion, être libre, faire des choix. Avec un spectacle filmé, quelqu’un a fait des choix pour vous. Dans une salle de théâtre ou d’opéra, vous êtes votre propre caméra3 ».
Alors, pourquoi ne pas s’affranchir de la salle ? Tout l’été, « l’espace public devient la scène estivale numéro 1 », écrit Rosita Boisseau4. Curieusement, note-t-elle, ce ne sont pas les spécialistes des arts de la rue qui l’ont soudainement investie, mais des chorégraphes ou metteurs en scène installés dans des centres nationaux, désireux de renouer avec le métier et les spectateurs. Une situation qui crée des tensions du côté des artistes de rue, alors que leur secteur est le moins aidé de la culture. D’autant que les règles sanitaires empêchent grandes parades et rassemblements festifs, rendant cette rue culturelle brusquement plus policée.
Ces tensions entre structures largement subventionnées et compagnies plus modestes, mais aussi entre une culture supposément élitiste et une autre plus populaire pourraient se rejouer dans des villes conquises par des coalitions gauche-écologistes aux dernières élections. L’exemple de Grenoble, dont le maire Éric Piolle est entré en conflit avec l’orchestre des Musiciens du Louvre (en 2014) et d’autres institutions de sa ville, conduit certains artistes à craindre un changement de politique dans certaines municipalités gagnées par les écologistes. Ces élus se posent en effet la question d’une démocratisation culturelle inachevée et défendent une culture pour tout le monde qui, selon leurs détracteurs, se ferait au détriment des grandes institutions nées de la décentralisation culturelle.
La part du lion
D’autant qu’à côté des grandes institutions, certains acteurs privés se tenaient prêts à saisir l’occasion. En effet, si certains artistes ont pu, grâce à leur inventivité, se jouer des contraintes, il ne saurait être question de fermer les yeux sur les difficultés que d’autres ont éprouvées ou subissent encore, pas plus que nous ne saurions ignorer la façon dont certaines entreprises se sont enrichies à l’occasion de cette crise sans contribuer pour autant à aider la création artistique.
Netflix en offre un exemple privilégié : l’augmentation des bénéfices pendant la crise (doublement des abonnements pendant le premier trimestre 2020) n’est pas simplement due à la diète imposée par la fermeture des salles de cinéma et de spectacle vivant, elle est sous-tendue par une stratégie élaborée. En effet, Netflix attire des artistes en leur offrant des budgets que des productions exigeantes ne leur proposeraient pas, comme pour The Irishman de Scorsese. Parallèlement, la plateforme mise sur l’exploitation du patrimoine : ainsi, en partenariat avec MK2, l’œuvre de Truffaut a été très consultée. Par ailleurs, Netflix a passé commande de courts-métrages à, entre autres, Ladj Ly, Pablo Larraín et la durassienne Naomi Kawase. Le discours du directeur général des contenus, Ted Sarandos, résume cette politique dans une admirable ambivalence : « Tout au long de la crise, les Français ont regardé davantage la télévision, ont redécouvert de nombreux films classiques européens et ont pu apprécier les œuvres de nombreux autres pays. Ces comportements nous ont rappelé la puissance et l’importance que prend la culture dans nos vies. […] Cela passe par accepter de montrer la face la moins louable de nos sociétés et défendre la cause de ceux que personne n’écoute5. » Il est exact que le premier film de Kery James et Leïla Sy, Banlieusards, a été vu des millions de fois sur Netflix (il a inspiré les producteurs des Misérables, associés au collectif Kourtrajmé). Mais rien ne dit que la plateforme continuera cette politique en direction des films d’art et essai, à moins qu’elle y trouve un marché fructueux.
Alors que le confinement a donné l’occasion de se tourner vers des activités relevant de la culture, nous avons l’impression de nous trouver à un tournant. Peut-être est-ce le moment de le négocier en envisageant les politiques culturelles d’un autre point de vue qui, sans ignorer la nécessaire donnée économique, ne se concentrent pas sur le seul critère de la rentabilité.
La part de l’État
Il semble que, depuis des années, la gestion culturelle par l’État se soit perdue dans ce que le directeur de la Réunion des musées nationaux, Chris Dercon, appelle ici même « la culture Excel, avec des listes et des numéros ». Un travers qui part sans doute d’une bonne intention : prouver que la culture n’est pas un simple supplément d’âme, mais qu’elle a aussi une utilité sociale, voire économique. Depuis le milieu des années 1980, les ministres successifs ont soutenu, face aux ministres des Finances, que leur secteur n’était pas un coût pour la collectivité, qu’il pouvait aussi rapporter de l’argent, créer des emplois et qu’il était rentable d’y investir. Cette vision a conduit, jusqu’à il y a peu, à des choix qui ont plus relevé de la mise en concurrence que de la nécessaire complémentarité des établissements culturels. Ainsi des communiqués de victoire quand un grand musée ou une grande exposition bat des records de fréquentation. « Le million, le million… », semblent espérer quelques lieux de culture, tandis que le tissu des lieux plus modestes, bien que soutenu par les collectivités territoriales, a plus de mal à vivre.
En effet, sans le domaine muséal et patrimonial, le système solidaire des musées nationaux a été déstabilisé dans les années 2000 par la multiplication d’établissements publics autonomes, comme le Louvre et Versailles, dont les revenus de billetterie ne profitent plus aux structures plus petites. Or, aujourd’hui, ces grands lieux de prestige, qui ont fondé leur succès sur la croissance des visiteurs étrangers, doivent dans l’urgence imaginer des solutions nouvelles. Une plus grande solidarité des institutions culturelles pourrait en être une.
Quand il assume ce rôle d’organisateur sans étouffer la création, l’État participe à l’éclosion de domaines d’excellence.
On se souvient que la France avait inventé des systèmes de solidarité imités jusqu’en Corée, comme la taxe spéciale additionnelle, perçue sur chaque entrée de cinéma et qui permet que les succès de blockbusters hollywoodiens financent des créations plus pointues. Quand il assume ce rôle d’organisateur sans étouffer la création, l’État participe à l’éclosion de domaines d’excellence. Il en va ainsi de l’animation, marquée en 2020 par la nomination d’un long-métrage français aux Oscars, J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Xavier Kawa-Topor, délégué général de la NEF Animation (Nouvelles écritures pour le film d’animation) explique cette réussite exceptionnelle par la conjonction « d’une rencontre notable entre art et industrie, fruit, d’une part, de tout le travail des écoles d’animation qui constituent un réseau d’excellence capté par l’industrie européenne et américaine, et d’autre part, de l’aide récemment consentie par le CNC pour la relocalisation de studios en France, à quoi s’ajoute l’arrivée d’une génération de jeunes spectateurs cinéphiles formés par l’animation japonaise ».
Miser sur l’éducation
Au niveau de l’État, la culture devrait faire l’objet d’une...
Lire la suite sur esprit.presse.fr