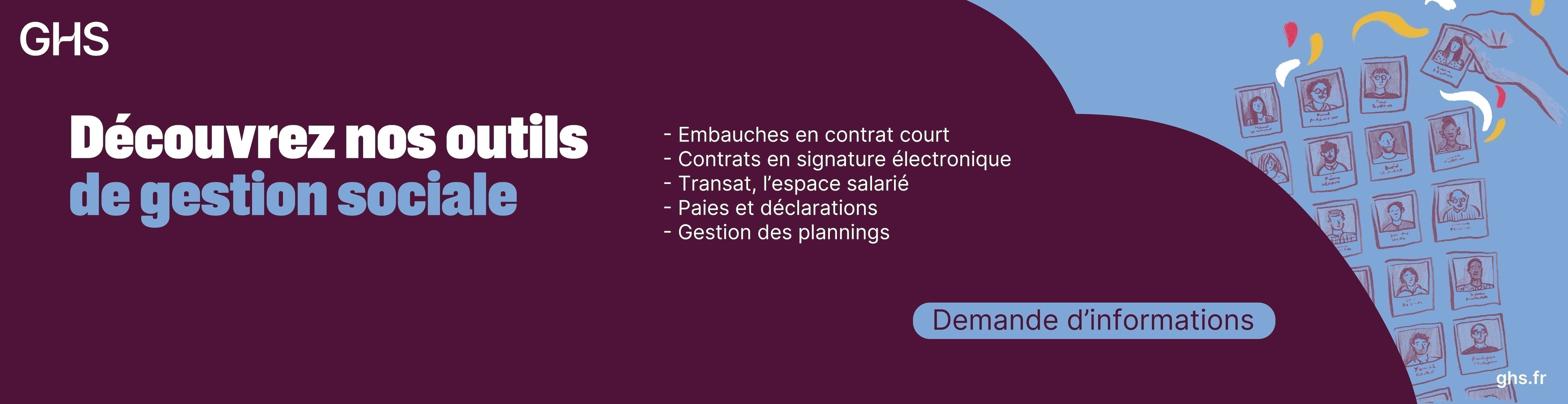Le dispositif censé offrir aux jeunes un meilleur accès à la culture voit sa part individuelle, critiquée, profondément modifiée, tandis que la part collective, plébiscitée, est gelée. Comment en est-on arrivé là ? Analyse.
Le pass Culture, c’est fini. Du moins dans la forme où il existait jusqu’au 1ᵉʳ mars. Désormais, les jeunes de 18 ans ne disposent plus d’un crédit de 300 euros, mais de la moitié seulement. Cette somme – 150 euros, donc – pourra être relevée à 200 pour ceux issus de milieux défavorisés et ceux bénéficiaires d’une allocation aux personnes handicapées. Autre nouveauté, ils auront désormais quatre ans pour la dépenser, et non plus deux comme c’était le cas. Enfin, comme Rachida Dati l’avait déjà laissé entendre lors du débat parlementaire sur le budget du ministère de la Culture, les 50 euros attribués aux 15 et 16 ans (respectivement 20 et 30) disparaissent, alors que ceux attribués aux jeunes de 17 ans passent de 30 à 50 euros.
Cette modification de la part individuelle du pass Culture va dans le bon sens. Elle répond partiellement aux multiples critiques faites à un outil de politique culturelle voulu par Emmanuel Macron qui s’est révélé extrêmement coûteux mais aussi, à l’usage, un instrument de reproduction sociale alors qu’il avait été notamment conçu pour ouvrir le monde de la culture à tous les jeunes, et en particulier ceux qui en étaient socialement les plus éloignés. Pour autant, cette modification souhaitable révèle aussi des postures plus contestables, et ne règle pas tout.
Hiérarchisation malsaine
Quand Rachida Dati est arrivée au ministère de la Culture en janvier 2024, elle s’est positionnée d’emblée pour une évolution du pass. Dans les faits, elle n’en a pas réduit les crédits en 2025 – et s’est même d’abord battue pour qu’ils ne le soient pas. Il a fallu d’importantes coupes budgétaires à la Culture, imposées par les gouvernements Barnier et Bayrou, et un amendement parlementaire voté contre l’avis du gouvernement pour que le montant du budget du pass soit ramené de 210 à 170 millions d’euros. Autrement dit, sa décision de modifier le dispositif du pass s’est faite sous une double contrainte – budgétaire et parlementaire –, qui a, à l’évidence, accéléré un calendrier qui n’était pas le sien.
Dans le monde de la culture, les contempteurs de la part individuelle du pass, que l’on trouve notamment dans les milieux du théâtre, estiment avoir gagné une première manche mais entendent continuer à se battre jusqu’à obtenir sa disparition pure et simple. Ils ne voient dans le pass qu’un outil de consommation culturelle (ce qui se défend) dont ils ne bénéficient quasiment pas (ce qui est une réalité) mais ont bien du mal à se remettre en cause sur la meilleure manière d’utiliser cet outil (on le mesure à la manière dont certains spectacles sont présentés sur l’appli) pour convaincre les jeunes que le théâtre puisse être un passionnant terrain de jeu de culturel. Plus gênant, les critiques ad nauseam entendues sur ces jeunes qui ne profitent du pass que pour acheter des mangas – ou, aujourd’hui, de la romance –, écouter du rap ou s’offrir des jeux vidéo renvoient à une...
Lire la suite sur telerama.fr