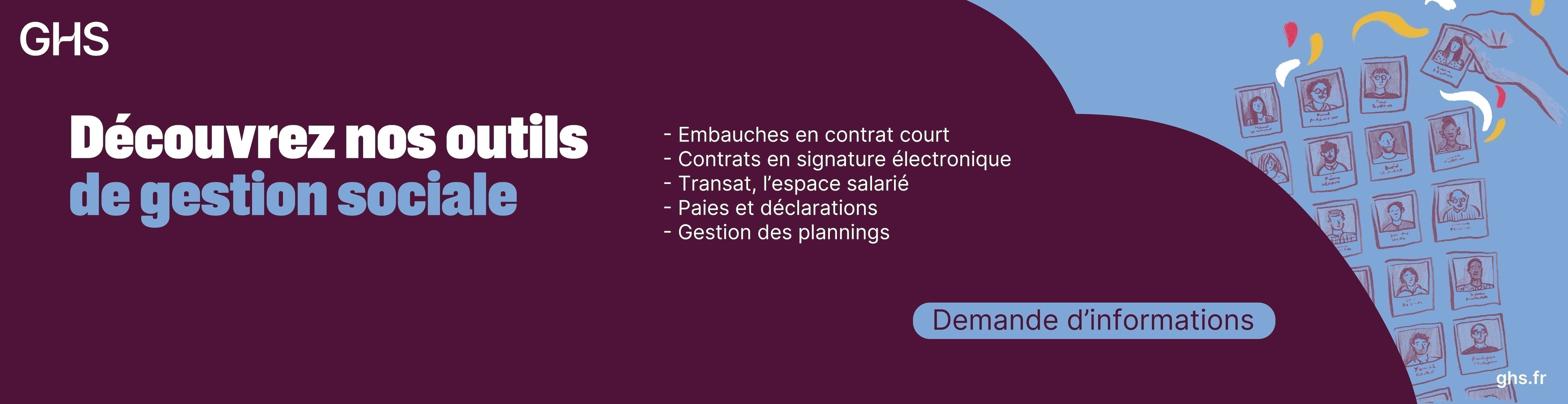Derrière ce vocable barbare se cachent un savoir-faire français de plus en plus recherché, une floraison d’agences indépendantes et le rêve pour les institutions hexagonales de trouver une source de financement.
Un jour, José-Manuel Gonçalvès a retourné le Centquatre. En 2008, les concepteurs de cet ambitieux centre culturel parisien, réhabilitant les anciennes pompes funèbres, avaient, en effet, ouvert ses portes sur le 104 de la rue d’Aubervilliers à Paris, face aux voies ferrées, tournant ainsi le dos aux cités de ce quartier populaire. Le lieu a végété jusqu’à ce que, nommé en 2010 à sa tête, l’ancien patron de La Ferme du Buisson, en Seine-et-Marne, tourne la boussole vers les tours, réussissant ce que bien peu ont jamais réussi dans le monde de la culture : mélanger les espaces (expositions, concerts, restaurants) et les publics (bourgeois, artistes, gamins des cités).
Depuis, le lieu sert de modèle. Pas une semaine sans qu’on y croise une délégation d’édiles en visite. Car quel maire, quel conseil régional n’a pas une friche dont il ne sait que faire ? En quarante ans, la géographie française a subi une profonde transformation. A la désindustrialisation et à la démilitarisation (Chirac met fin au service militaire en 1996) qui ont libéré des kilomètres carrés de bâtiments menacés de ruine se sont ajoutées, en 1982, les lois sur la décentralisation qui en ont fait reposer le poids sur les épaules des élus locaux.
« Comme les gens qui entrent ici, l’art m’a sorti des déterminismes sociaux, témoigne le directeur du Centquatre, qui, à 63 ans, s’apprête à quitter son poste cet automne. C’est ce que les décideurs qui nous demandent de les accompagner recherchent : un lieu qui ne soit pas seulement artistique mais s’inscrive plus largement dans une politique de la ville. » On appelle cela l’ingénierie culturelle.
Si le vocable sonne comme un oxymore (le sensible et le fonctionnel, la poésie et l’industrie, érigés sur le même plan), c’est qu’il abrite l’idée d’un savoir-faire longuement acquis et aujourd’hui monétisable. Au point d’avoir, en grande partie, remplacé le mécénat dans la colonne recettes des institutions publiques. « Toucher 500 000 euros de donations par an, c’est un maximum, et encore on parle des plus grosses, affirme José-Manuel Gonçalvès. Aujourd’hui, l’ingénierie culturelle au Centquatre, c’est quatre millions d’euros. » Ici, les trois postes chargés du mécénat ont laissé place à un département d’une douzaine de personnes pour répondre à cette nouvelle économie.
Champ d’action immense
Le Louvre, le Palais de Tokyo, le Centre Pompidou, l’Institut du monde arabe, la Gaîté-Lyrique… Tous rêvent du sésame et mettent en place des structures. Il faut dire que le champ d’action est immense : hôpitaux, casernes, usines abandonnés auxquels imaginer un autre futur, sans compter les labellisations en tout genre (capitales de la culture) dont il faut accompagner les candidatures, ou ces quartiers « culturels » qui se développent dans le giron des projets immobiliers, à l’instar de Fast à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) de la Fondation Fiminco.
Mieux : le phénomène, né de la décentralisation culturelle sur les ruines des « trente glorieuses », s’est encore renforcé ces dix dernières années avec la demande mondiale, notamment en Asie et au Moyen-Orient, où l’expertise française en matière de culture apparaît comme une valeur première. Ainsi d’Al-Ula, cette région du nord-est de l’Arabie saoudite que les émirs veulent transformer en eldorado touristique.
« Question des publics »
Boulevard de la Bastille, le long du bassin de l’Arsenal, les chevilles ouvrières de l’agence Manifesto ont trouvé refuge au dernier étage d’un ancien immeuble industriel : directeurs artistiques, programmateurs, designers, muséologues, scénographes, urbanistes… Ils sont une vingtaine ce jour-là penchés sur leurs ordinateurs sans qu’on entende une mouche voler.
Dans le bocal central qui sert à la fois de salle de réunion et de bureau, Laure Confavreux-Colliex, 44 ans, qui a cofondé la société, tente une explication de texte : « Notre mission est d’accompagner la tenue d’un budget, d’un calendrier, de donner les éléments de décision aux porteurs de projets. On partage ainsi dix, quinze, vingt ans d’expérience. » Littéraire passée par une école de commerce, l’Essec, elle a fait ses classes au...
Lire la suite sur lemonde.fr