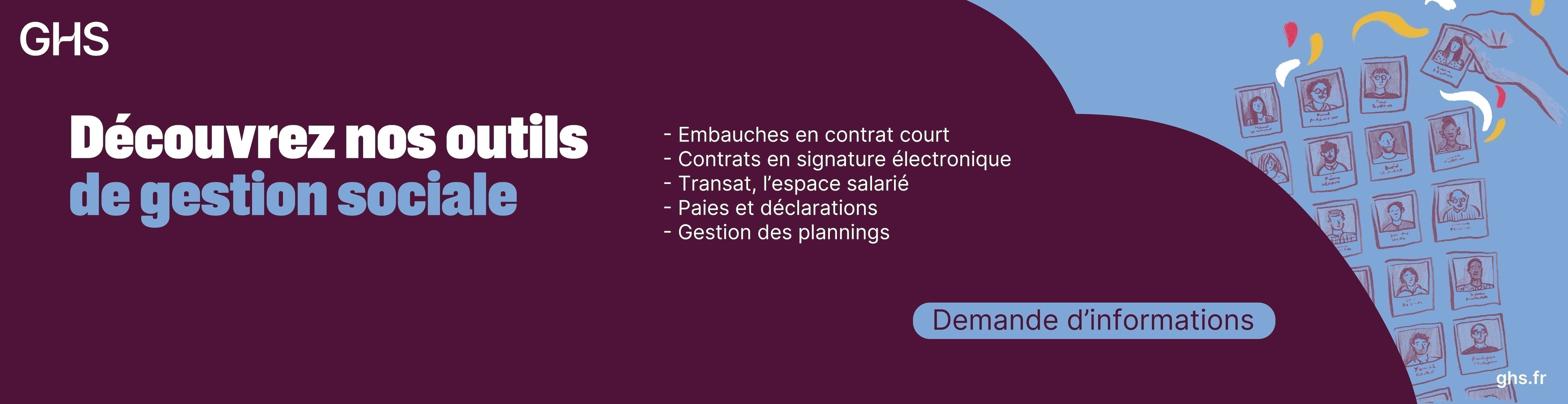Scènes musicales, Friches culturelles, lieux intermédiaires, tiers lieux, la dénomination des lieux culturels ces dernières décennies reflète le sens et les enjeux accordés à la culture dans la société à un moment donné. Effectivement, ils sont le point de jonction entre des dispositifs territoriaux et des processus artistiques.
Le propos de cet article est moins d’en faire une comparaison historique que d’interroger le rapport entre lieux, culture, société et territoire. Nous verrons qu’autour des enjeux que représentent ces centralités, se sont produites alternativement des tensions entre instrumentalisation et autonomisation.
Un chemin de crête difficile à tenir
Dans l’idéal, les politiques culturelles indiquent que la culture ne peut être réduite à un bien marchand, c’est un bien commun partagé universellement à travers la portée symbolique de l’art rendu accessible (démocratisation culturelle) par l’action culturelle avec ses lieux dédiés comme le furent les Maisons de la Culture. La pensée politique de la culture rétorque que la culture ne peut être séparée des autres dimensions de ce qui fait société, elle en est même aux sources et par conséquent constitue un droit fondamental garant d’une diversité et d’une émancipation (démocratie culturelle) résumée par la notion de « droits culturels ».
Les lieux culturels sur le plan axiologique se situent exactement sur la ligne de crête entre ces deux versants et visions de la culture. Leur traduction méthodologique les placerait entre dispositifs de production professionnelle (création/diffusion) et animation socioculturelle (sensibilisation/ transmission). De fait, les lieux culturels posent un référentiel sur ce que devrait être le rôle de l’art en société entre « un art pour l’art » et « un art social ». Mais ils établissent en même temps un lien d’interdépendance avec un environnement en termes de socialisation d’expériences et conjugaisons de compétences.
Les lieux se fondent donc autour de supports et de rapports dans une relation réciproque avec un territoire : ils le construisent et sont construits par lui. C’est un mouvement de dépliement et de repliement. C’est un schéma développement culturel pour qui le territoire est une forme vivante et ne se fige pas derrière des frontières. Cela commence par une certaine conception de l’espace public, bien avant les lieux, les arts de la rue comme l’art graffiti posait la question de la socialisation de l’art dans cet espace négocié entre libre expression et contrôle des corps, entre espaces autonomes et marchandisation de l’espace.
La gestion de l’espace des lieux n’y échappe pas et son histoire nous rappelle combien le parcours sur ce chemin de crête est difficile à tenir sans être instrumentalisé.
L’instrumentalisation des lieux
À titre d’exemple, la génération rock des années 70/80 a revendiqué le droit d’accéder comme toutes autres pratiques artistiques à des lieux de répétitions et de diffusion. L’instauration du réseau des Scènes des Musiques Actuelles (SMAC) a répondu à ce besoin légitime tout en labellisant ces musiques dites « amplifiée » en « musiques actuelles ». Le cahier des charges des SMAC correspond aux deux versants de la culture : donner des moyens de production et diffusion professionnelle tout en assurant un accompagnement des pratiques sur un territoire. Mais la professionnalisation des métiers de la culture et les modes de financement/légitimation conduit à une sectorisation de la culture, la création d’une filière générant son propre savoir technicien, sa propre culture de fonctionnement et ses logiques de financement en « tuyau » s’éloignant de la culture alternative des origines.
Les lieux perdent en mouvement et reproduisent des frontières. D’ailleurs la génération suivante des années 80/90 issue du hip-hop va assez peu s’y reconnaître et s’y investir. Bien qu’ayant reçu elle aussi une labellisation par l’institution sous l’énoncé « cultures urbaines », les retombées ne seront pas les mêmes, car les modalités de structuration professionnelle des pratiques artistiques, notamment le rap, passeront beaucoup moins par des lieux culturels dédiés. Leur grammaire culturelle se conjugue plus dans des espaces édictant leurs propres règles de validation sans éviter pour autant une récupération par l’industrie culturelle. D’où la paradoxale recherche perpétuelle malgré leur poids économique à la fois d’une reconnaissance et d’une indépendance.
Nous parlons ici du rapport des lieux avec les formes populaires émergentes, mais les mêmes questions résident pour d’autres formes validées par le « monde de l’art » à l’instar de l’art contemporain7. Dans tous les cas, le passage par les lieux culturels apparaît comme l’instrument privilégié d’une institutionnalisation par la légitimité esthétique (validation d’une excellence artistique par les autorités de tutelle) et la notabilité territoriale (partenariat dans l’orientation des politiques publiques).
Lieux en friche, friches en lieu
D’autres lieux dans la même période, comme le réseau de centres culturels indépendants Trans Europe Halles, chercheront à sortir de cette quadrature du cercle. Malgré leur décalage par rapport aux fonctionnements institués, les friches culturelles furent anoblies sous l’intitulé « Nouveaux Territoires de l’Art » suite au rapport Lextrait (2001) sans que cette reconnaissance institutionnelle dégage de vrais moyens.
Il n’en demeure pas moins remarquable cette dimension transdisciplinaire et transectorielle propre aux interstices qui se logent dans les zones d’effondrement post-industriel puisque le propre des friches et des squats est de s’établir dans les « délaissés » échappant temporairement à l’emprise utilitariste technocratique ou productiviste.
Alors que s’effectuait un changement de paradigme économique (du capitalisme industriel vers un capitalisme financier, de plate-forme et cognitif), un autre effondrement s’opérait. La chute du mur de Berlin ouvrait la brèche sur des relations internationales multipolaires dans laquelle viendront s’engouffrer des mouvements créatifs altermondialistes, renouant le lien entre art et politique, accès à l’œuvre et plaisir de la fête, contre-espaces et contre-culture ; bref, une autre manière de réinterroger le rôle de l’art comme « art total » reliant culture vivante, culture transmise et culture symbolique.
Il s’agissait notamment de sortir la création de l’opposition entre l’artistique et le socioculturel en donnant les moyens à chacun d’exprimer ses propres valeurs esthétiques dans une totalité qui fait sens. Durant cette période des années 90 nous nous étions intéressés particulièrement à un dispositif révélateur de ces évolutions : les ateliers d’artistes des pays du Sud en résidence dans les quartiers populaires en France dont la propriété novatrice était de n’être justement pas classifié dans des lieux.
Ce « social-art » articule un travail artistique (l’atelier) et une création sociale (la résidence) en croisant quatre processus habituellement séparés dans leur forme instituée : création (mise en forme), transmission (mise en lien), sensibilisation (mise en sens), diffusion (mise en scène).
Entre l’espace de la rue, de l’atelier, du « work in progress » et de la scène, la restitution de cette complexité respecte l’implication humaine dans son intégrité (échappant à la catégorisation des champs d’intervention sociale ou culturelle) pour mieux redéfinir le champ de l’expérience en matière de pratiques culturelles, sociales et artistiques. Elle permet également de poser un repère dans une praxis comme lieu d’interrogation et de redéfinition du champ des pratiques professionnelles dans son contexte politique.
Bref, être hors lieux, se loger dans les interstices, produit un déplacement autant spatial, mental que social et dans ce décalage rend...
Lire la suite sur tierslieux.anct.gouv.fr