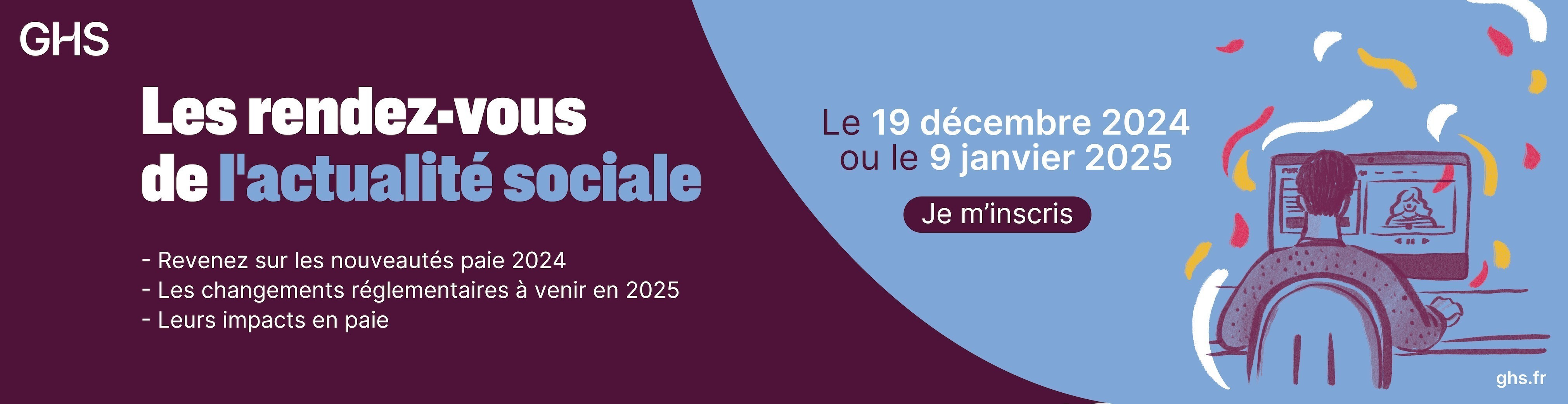Le gouvernement vient de décider, sans le dire officiellement, de geler les financements alloués à la part collective du pass Culture, qui permet de financer une large part de l’action culturelle dans le scolaire. Chefs d’établissement, enseignants et partenaires ne décolèrent pas.
On a cru au compte à rebours d’un mauvais film d’action. Aux dernières heures de janvier, c’est fini, les caisses de la part collective du pass Culture, réservées aux établissements scolaires afin de financer spectacles, expositions, ateliers, sorties, se sont retrouvées vides. Vendredi, à 16 heures, toute réservation était même bloquée.
Affolement général dans le monde de la culture et de l’éducation. Les professeur·es et les chef·fes d’établissements se sont pourtant pressé·es depuis jeudi pour valider des projets, et les partenaires culturels pour proposer les leurs. Tout cela dans l’espoir de grappiller les euros restants avant que le robinet ne soit coupé jusqu’en juin, dans le cadre d’un dispositif qui était censé durer toute une année scolaire. Les connexions à la plateforme en ligne ont frôlé le million, un tel point de surchauffe que le site a fini par planter jeudi 30 janvier.
L’information bruissait depuis une semaine dans le secret de la haute administration, elle a finalement été dévoilée mercredi par visioconférence à toutes les délégations académiques à l’action culturelle de France. Sous la pression de Bercy, le ministère de l’éducation sabre en catastrophe dans le budget : au lieu des 97 millions d’euros prévus, le budget du pass Culture scolaire passe à 72 millions, et il faut encore garder sur cette somme 22 millions afin d’assurer les mois de septembre à décembre 2025.
Ce n’est pas un gel, ni une mise en pause, se défend le ministère dans ses éléments de langage, puisqu’il resterait sur cette enveloppe encore 50 millions. La réalité est nettement moins avantageuse, car 40 millions ont été déjà dépensés depuis septembre… C’est donc 10 millions qui restaient bel et bien à consommer, dans la panique absolue et pour tous les établissements scolaires du pays, ces dernières quarante-huit heures. Et si on regarde la courbe des dépenses des années précédentes entre septembre et juin, un manque à gagner bien réel pour la culture à l’école.
D’après nos informations, à l’occasion de cette réunion en visioconférence, plusieurs responsables académiques ont fait savoir leur vive inquiétude. « Tout le monde est conscient du tsunami de mécontentement que cela va occasionner », indiquait un acteur académique du sud de la France. « Est-ce qu’on prévoit une répartition entre académies, ou est-ce que c’est “premier arrivé, premier servi” ? », s’interroge un autre, quand un troisième, dans l’Ouest, demandait benoîtement à ses collègues : « Donc c’est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit ? »
Acteurs culturels en panique
À l’autre bout de la chaîne, les chef·fes d’établissement n’en reviennent pas non plus. La plupart ont appris la nouvelle par les enseignantes et les enseignants, eux-mêmes avertis par les acteurs culturels avec lesquels ils ont l’habitude de travailler. « C’est une nouvelle crise, on piétine notre travail, déclare Bruno Bobkiewicz à l’occasion d’une conférence de presse de son syndicat, le SNPDEN-Unsa. Nous étions jour et nuit ensemble ces derniers jours pour un conseil social et économique ministériel, et personne n’a jugé utile de nous prévenir de cette affaire ? »
La méthode a surtout un air de déjà-vu : l’an passé, en avril, les principaux, principales et proviseur·es avaient découvert aussi du jour au lendemain que toutes les heures permettant de financer des projets pédagogiques ou d’assurer des remplacements étaient gelées, sine die. Une protestation nourrie avait alors permis d’inverser la vapeur.
"C’est certain qu’il va y avoir de la perte"
Gabrielle Sébire, Cinémathèque française
Du côté des partenaires culturels, théâtres, compagnies ou institutions de promotion du cinéma, l’information a d’abord circulé sous le manteau, alimentant la machine à panique. Gabrielle Sébire, directrice de l’action culturelle de la Cinémathèque française à Paris, très attachée à la médiation vers les scolaires, rappelle que l’an passé, près de la moitié des visites d’élèves a été payée par le biais du pass Culture collectif.
Mécaniquement, si le budget se tarit maintenant, c’est un trou énorme dans l’action d’éducation au cinéma patrimonial de l’institution. « Ceux qui avaient réservé en début d’année, pour une visite en avril, ça ira. Les autres, on a essayé de les prévenir de valider au plus vite leur projet, mais c’est certain qu’il va y avoir de la perte », explique la directrice.
Au théâtre Antoine-Vitez à Ivry, en banlieue parisienne, cela fait deux jours non-stop que Clara Lorenzo, responsable du jeune public et de l’action culturelle, tente, elle aussi, de sauver les meubles. « Nous ne sommes pas une structure qui met toutes ses offres en ligne en septembre et on n’en parle plus. Pour être au plus proches des établissements scolaires, de leurs envies, on construit nos projets et on les publie tout au long de l’année. Là, j’ai créé en catastrophe 19 offres, et demandé aux professeurs et aux chefs d’établissements de les valider au plus vite. »
Douze sont en cours d’instruction, cinq validées, deux préréservées, la plateforme fonctionnant au ralenti. Concrètement, pour ce théâtre, c’est potentiellement trois spectacles sans public d’ici juin, et vingt-quatre heures d’atelier avec des artistes qui passent à la trappe, sans même parler des pertes de billetterie.
Absence de pilotage
« C’est la foire d’empoigne depuis quarante-huit heures, confirme la secrétaire générale du théâtre, Lucie Cabiac. Dans la commune, l’émancipation par la culture est un point central de notre politique. Et eux, au ministère, ils n’ont même pas eu la décence de mettre en place un pilotage, par exemple sur les zones d’éducation prioritaire, pour amortir le choc ? La plupart de nos jeunes à Ivry ne vont pas à la Comédie-Française avec leurs parents, s’ils n’y vont pas avec l’école, ils n’iront pas au théâtre du tout ! »
L’absence de réel pilotage du pass Culture, dévoilée de manière criante par cette dernière volte-face budgétaire, est un élément de...
Lire la suite sur mediapart.fr